Lorsque nous embarquons pour aller passer la journée à San Marcos, capitale du district du même nom, pour une fois il ne fait plus nuit … et ce n’est ni l’aube ni même le petit matin. On s’est laissé dormir un peu. Comme je parle de district, je me permets une petite digression administrative. Au Pérou, on trouve d’abord les départements (aussi appelés régions, selon les cas), qui organisent des élections régionales (les prochaines auront lieu en octobre 2010). Cajamarca est ainsi la capitale de son département/région. Puis, au sein des départements, il y a des provinces et des capitales provinciales. Par exemple, dans
le département de Cajamarca , on trouve 13 provinces dont celle de Cajarmarca, celle de San Marcos, celle de Jaen et celle de San Ignacio, les quatre provinces que nous allons visiter. Enfin, au sein des provinces, on trouve des districts.
San Marcos où nous passons la journée, est la capitale du district de San Marcos de la province de San Marcos, elle-même située dans le département de Cajamarca. Voilà, désolée, c’est un peu fastidieux, mais bon, on sait jamais, si la question tombe au trivial poursuite genius genius spécial pays d’Amérique Latine, grâce à Irkita, vous serez incollables !
A l’origine de notre déplacement ici, la résistance victorieuse à un projet minier, dixit la directrice de Grufides. Nous avons donc voulu aller voir cela de plus près.
L’abondance
Lorsque nous arrivons à San Marcos, il est à peu près midi. Ici, c’est la foire, au sens premier du terme. Tous les dimanches, les paysans et les éleveurs des alentours descendent en ville pour vendre leurs productions. A la vue de l’abondance présente ici, on sourit (pourquoi ne chat-on jamais, hein ?) en se remémorant le refrain de l’industrie minière et du gouvernement vantant le développement et la richesse que l’exploitation minière et autres activités extractives sont censées apporter, et sans qui les pauvres bouseux du coin meurent de faim. Ce qui est de toutes façons faux, parce qu’en dernier recours, les gens du coin auront toujours la possibilité d’avaler
le grand chapeau qu’ils sont nombreux à porter, typique de la région de Cajamarca. Et c’est ce qui risque de se passer si on ne prête pas attention à leur volonté de ne pas voir l’industrie minière s’installer chez eux, même si, vu la fertilité des terres d’ici, il en faudra des kilos de cyanure pour que les gens se retrouvent avec plus rien à manger. En quasiment quatre mois de voyage, on a rarement vu de vaches si athlétiques, de cochons si heureux d’être sales, de chevaux si fringants, autant de fruits différents, autant de variétés de légumes, autant de couleurs sur les étales.
Au milieu de ce foisonnement de vie, un sac trainant par terre remplis de mes cousins cochons d’Inde (qu’on a l’indécence d’appeler «
cuy » ici), me fait un peu mal au cœur. Ici, on les mange, un peu comme on mange le poulet du dimanche. Mais le pire reste à venir. Anna et Jérémy, ces sauvages, vont en prendre un pour déjeuner à midi. D’accord, ils mangent n’importe quoi, mais cette fois-ci, le coup est de trop pour moi. Voir mes deux compagnons dévorer à pleines dents un cousin me chamboule complètement. C’est décidé, il faut que j’assume ma condition de souris voyageuse. Finit l’allure ringarde. De retour à Cajamarca, je passe chez un
relookeur, comme j’ai vu à la télé, et on va voir ce qu’on va voir. En attendant, je ronge mon frein, faute de pouvoir ronger un chapeau de Cajamarquais, à qui cela ne plairait surement pas … en plus, il risquerait de vouloir me manger en retour !
Suite à ce repas cauchemardesque, nous filons chez «
les petites sœurs de Jésus », un ordre de religieuses contemplatives, pour y rencontrer l’une d’entre elles (une Brésilienne) afin qu’elle nous raconte l’histoire de la résistance à la mine, car nous sommes quand même là pour ça. « Malheureusement elle est partie en retraite tôt ce matin», nous informent deux de ses consœurs qui nous accueillent. L’une d’entre elles est d’ailleurs une française de Haute-Savoie qui est au Pérou depuis 1953. Incroyable, non ?
Dans tous les cas, elles nous offrent à boire un café, un vrai. Mmmm. Un café autre que de l’instantané, ça fait plaisir. Et oui, ça peut être surprenant, mais on boit très peut de « vrai » café au Pérou, alors qu’il s’agit de
son premier produit d’exportation agricole. La production péruvienne est essentiellement destinée à l’exportation. J’en profite pour prouver mon début de transformation en jouant avec des chatons, qui grouillent par terre, à qui j’apprends à respecter les souris. Puis, comme le temps file et que rien ne se passe chez les petites sœurs, sur leur conseil, nous partons à la recherche du curé de la ville, qui aurait aussi participé à la résistance.
Pouf, plouf. Ca, c’est le bruit des bombes à eau qui accompagnent la période du Carnaval à Cajamarca. Encore une fois, elles ne sont pas passées loin. Ici, le Carnaval de la région est l’équivalent péruvien de celui de Rio pour les Brésiliens, une véritable institution. Nous sommes à moins d’un mois avant son début, autant dire quasiment pendant, puisque les gens se préparent depuis 6 mois, et, pour permettre de patienter jusqu’au jour J, il y a quelques traditions, comme des préliminaires ou comme un échauffement. Sur la place centrale de Cajamarca par exemple, tous les vendredis et samedis soirs, des groupes de jeunes se réunissent pour jouer du tambour et de la flute et pour chanter en cercle, autour duquel se forme rapidement un autre cercle de spectateurs, chantant aussi. Puis, l’un des quartiers de la ville vient pour chauffer un peu plus l’ambiance en faisant le tour de la plaza de armas. Il parait que c’est la force de la culture. Dans tous les cas, j’aime bien la musique un peu médiévale de ces jeunes. Une autre des traditions est la bombe à eau, sous forme de ballon de baudruche la plupart du temps, voire d’un seau d’eau, carrément (!), une spécialité des minibus. On a vu des victimes se retrouver trempées de la tête aux pieds en un instant, alors qu’elles marchaient tranquillement dans la rue.
Bien entendu, nous sommes des cibles privilégiés. Faut dire qu’on nous repère facilement. Des blondes, il n’y en a pas beaucoup dans le coin. Plouf, plouf. Raté ! « Padre Lazaro? Padre Lazaro ? ». On se renseigne. Sa maison est en face de l’Eglise, sur la place. Nous le croisons. Il est d’accord pour nous consacrer un peu de temps avant son office de 17h.
L’entretien dérive rapidement sur des questions de politique nationale. Pour lui, il n’y a pas de bon candidat qui aurait des chances de gagner, il n’y a qu’un « moins pire » : un ancien président, Toledo, « parce qu’au moins, avec lui, on avait le temps de respirer ». Finalement, il appelle le secrétaire général du Front de défense du fleuve Cajamarquino, l’association des habitants de trois provinces qui résistent à la mine, nous avouant qu’il a été absent les deux années les plus intenses de lutte pour cause de dépression. On a beau être curé, on a quand même le droit de déprimer, non ? Surtout quand on voit ce qui se passe dans sa paroisse… Padre Lazaro a quand même le temps de nous expliquer le rôle qu’il a joué dans les mobilisations anti-minières. «
Nous sommes allés voir les communautés, dans les campagnes, pour parler de la mine, pas pour parler contre la mine. Puisque les mines donnent seulement le bon côté des choses, nous avons souhaité que les paysans connaissent aussi l’autre côté, comme ce qui se passe déjà à Cerro de Pasco, à Tambogrande ou à Piura. Ensuite, c’est à eux d’en tirer leurs propres conclusions».
De la fausse vraie naïveté ? « La mine, ça pollue ton eau et ça rend malade tes enfants ». Facile de choisir, non ? En homme d’Eglise, il nous précise qu’ils ont été très prudents et qu’ils n’ont pas poussé les gens à se lever contre la mine. «
C’est aux personnes de décider si elles souhaitent devenir protagonistes, si elles souhaitent jouer un rôle historique » Est-ce que le Padre a vraiment déprimé ou est-ce qu’il a été invité à se retirer pendant un moment comme le père Marco Arana avait été invité à étudier à Rome après avoir commencé à mettre son nez dans les affaires de
Yanacocha ?
Mais revenons à l’expérience victorieuse de lutte anti-minière à San Marcos. Nous l’apprendrons surtout de la bouche du secrétaire général du Front de défense du fleuve Cajamarquino. L’histoire est classique. L’entreprise minière Miski Mayo (Brésil) arrive dans la région en 2004. Pour accéder au site de la concession de 14 000 hectares qui lui avait été attribuée, elle a besoin de construire une route et, pour cela, d’exproprier des paysans dont les terres se trouvent sur le tracé. La réaction est rapide, c’est le début de résistance. Les membres du front de résistance qui se forme sur le champ réussissent à empêcher la construction de cette route illégale.
Au passage, on apprend que, bien plus en amont de cette lutte, l’Eglise avait joué un rôle important, voire central, dans le processus de conscientisation. Dès les années 70, elle a mis en place des programmes d’éducation à l’environnement pour les habitants des environs, nous explique le dirigeant, un professeur d’école. «
Je suis fils d’un dirigeant écologiste », nous confie-t-il. Avant sa naissance, les organisations religieuses avaient déjà fait un grand travail de sensibilisation auprès des paysans sur l’importance de l’eau pour la vie. Alors, forcément, lorsque, par la suite, leur curé leur explique que l’un des principaux impacts de l’activité minière est justement la pollution aquatique, la réaction ne se fait pas beaucoup attendre. Il nous confirme aussi le fait que pour les paysans de la région, il y a eu un avant et
un après Choropampa. Comme quoi, faire des documentaires, c’est bien efficace ! Et puis, il y a l’exemple d’autres villes minières du pays,
comme celui de La Oroya ou mieux, celui du
Cerro de Pasco, avec ses 400 ans d’activité minière.
« L’argent généré par l’activité minière est momentané. La mine est temporaire. Il s’agit d’un développement pour un petit groupe de Péruviens, mais avant tout pour quelques étrangers. Nous souhaitons défendre nos terres qui sont fertiles. Ici, nous ne voulons pas du développement minier, mais celui de nos champs. C’est une source de vie sûre ! ». C’est la protection de la terre, celle qui les nourrît, qui anime avant tout la volonté des habitants de San Marcos.
Acte 2 : Réponses de l’entreprise minière
Face à la résistance, l’entreprise sort sa liasse de billets et entreprend la seconde étape du manuel du « parfait petit mineur », celle de « l’achat des consciences ». Cette étape dure 4 ans. L’entreprise commence par les hommes politiques, «
les plus faciles à acheter ». Puis, en fonction des spécificités locales, elle poursuit sa tournée en corrompant les dirigeants des organisations populaires. Dans la zone de San Marcos, il s’agit avant tout des « rondes paysannes » (rondas campesinas). Et pour ceux que l’entreprise n’arrive pas à acheter, elle les invite à participer à des ateliers de « formation » et à des rencontres sportives. C’est comme cela qu’elle se fait une place dans le paysage local et qu’elle se crée une base populaire. Et quand l’argent ne suffit plus, on passe à l’option « paramilitaires » (le plan B du « parfait petit mineur »). L’entreprise arme d’anciens
senderistas afin que ceux-ci aident les paysans à se persuader du bien fait de l’activité minière ou à vendre leurs terrains.
L’argent finit par payer. En 2007, le front de résistance apprend que l’entreprise a commencé l’exploration. Elle a construit une autre route en passant cette fois par le district voisin, celui de Cajamarca (souvenez-vous du découpage administratif péruvien et des exemples en début de ce billet). Des paramilitaires auraient aidé les propriétaires des terrains traversés par cette route à accepter les propositions de la mine … en les empêchant de revenir sur leur terrain. Immédiatement, un demi-millier de paysans décident de renouveler l’exploit de 2004 en allant bloquer les installations de la mine. Ils vont se rendre compte qu’en pensant avoir gagné la première fois, ils ont laissé le temps à la compagnie minière d’affiner sa stratégie. Un comité d’accueil composé de policiers, mais aussi de paysans armés les attend. Si l’affrontement est évité, le mal est fait. « Avant, on se parlait entre voisins. La mine a amené l’individualisme ». Mais surtout, en divisant les communautés en « pro » et « anti » mine, elle a introduit les germes de sa dislocation, puisqu’une communauté où les gens ne se parlent plus, n’est plus tout à fait une communauté.
Depuis, les choses se poursuivent de la même façon: blocages réussis, tentatives d’achat des dirigeants, dépôt de plainte avec l’aide de Grufides, contre-attaque judiciaire de l’entreprise, poursuites policières contre les paysans. Aujourd’hui,
le front de défense continue la lutte en préparant les prochaines batailles. 60% de la province étant concessioné, il y en aura malheureusement probablement d’autres. Son travail se poursuit dans les domaines juridique et technique, mais aussi en faisant un inventaire exhaustif des ressources naturelles (sources d’eaux, plantes, animaux, etc.) se situant sur les concessions. Cela pourra servir d’arguments plus tard. Enfin, ils souhaiteraient mettre en place un mécanisme de consultation populaire comme ce fut le cas à
Tambogrande, mais ils n’ont ni les moyens financiers, ni les mairies qui les soutiennent…
On apprend aussi comment cela fonctionne au niveau des batailles judiciaires. Puisque l’entreprise commet des actes contraires à la loi (expropriations forcées, corruption, utilisation d’armes sans permis, etc.), une plainte est déposée contre elle. Mais, coup de baguette magique, elle change de nom et continue son activité. Aujourd’hui, on ne parle plus de Miski Mayo, mais de
Vale do Peru, les actionnaires n’ayant évidement pas changé.
En revanche, les personnes qui résistent, ne changent pas de nom. Il faut savoir que le Pérou, en plus d’avoir plus de concessions minières et pétrolières que de sites archéologiques visitables, possède tout un arsenal juridique visant à criminaliser la protestation sociale. On est très rapidement taxés de terroriste, ce qui fait basculer les procédures de poursuite dans un cadre particulier. Ce n’est pas la police qui vient vous chercher par exemple, mais des forces spéciales. L’ami que nous avons en face de nous nous explique de nombreux paysan, « de dangereux terroristes », sont en liberté conditionnelle. Ils ont évité la prison seulement grâce à l’aide d’organisations internationales. Comme quoi, les campagnes internationales de soutien qu’on voit passer de temps en temps et qu’on signe parfois avec doutes quant à leur succès, ont des impacts et peuvent, un peu, améliorer des situations dramatiques. Ca réconforte un peu de savoir que le peu qu’on fait de loin sert parfois à quelque chose.
Suspension d’activité, mais toujours aux aguets (du marché boursier ?)
Bilan de la résistance à San Marcos ? Pour l’instant, l’activité minière n’a toujours pas débuté, mais l’entreprise rode toujours et attend des jours encore plus favorables. Au final, devant le pouvoir judiciaire – car c’est aussi sur ce terrain que se situe le combat - on se demande vraiment ce que peuvent faire des personnes qui ne possèdent qu’une seule et unique identité face à des entreprises qui, grâce au concept de personnalité morale, peuvent changer de visage tous les jours, tout en conservant à leurs commandes les mêmes personnes physiques, toujours intouchables.
Pour le moment, et même si l’entreprise a suspendu son activité, l’histoire de la lutte anti-minière à San Marcos n’est pas terminée. Comme ailleurs, elle ne le sera que lorsque le gouvernement péruvien aura revu sa méthode de développement du pays, en concertation avec les populations locales. Aujourd’hui pourtant, c’est plutôt le contraire. Le président péruvien a affiché sa volonté de construire un « train andin » de la région de Cajamarca à Piura pour acheminer des minerais. En attendant des jours meilleurs, avec mes copains humains, cochons, canards, poules, moutons, ânes, cuyes (snif) et j’en oublie, nous continuerons à dire, groin, coin-coin, cot-cot, kri kri, meuh, hi-han, cui-cui,
no a la mina et si a la vida !
--
Kri kri,
Irkita

 Évidement, les deux rabat-joies qui m’accompagnent ne m’ont pas amenée ici pour me faire plaisir, ni pour que je puisse me régaler avec du
Évidement, les deux rabat-joies qui m’accompagnent ne m’ont pas amenée ici pour me faire plaisir, ni pour que je puisse me régaler avec du  Pour en revenir à
Pour en revenir à  C’est pourtant ce qu’à dû subir un jeune prêtre envoyé évangéliser les populations paysannes dans les campagnes reculées autour de Cajamarca, qui, très peu de temps après l’installation de la mine, se fait porte-parole des ses paroissiens. Fidèle aux principes humanistes de l’Evangile, celui-ci ne peut rester silencieux lorsqu’il prend connaissance de la bouche des habitants du village de Porcon des méthodes d’expropriation employées par la compagnie minière. Car le droit de propriété péruvien est ainsi fait que si le paysan (ou une communauté paysanne) est propriétaire d’un terrain, les ressources de ce terrain ne lui appartiennent pas et ce qui se cache sous sa maison peut ainsi être loué par l’Etat sans même l’en informer (même si l’entreprise bénéficiaire est censée, par la suite, obtenir son accord…enfin, ça, c’est ce qui est écrit sur du papier). Sympathique comme conception de la propriété privée (et collective), non ? A l’époque, il n’existait pas de route pour accéder à ces villages distants seulement de 30 kilomètres de la grande ville. Ce qui, à pieds, constituait tout un périple et favorisait le complexe d’isolement des paysans. C’est comme cela que les premières expropriations se furent silencieusement, sous contrainte de la menace : « soit tu parts avec ce qu’on te donne, soit cela se fait par la force ». Si c’est un homme « blanc » et riche qui parle, alors on obéit. Les premiers hectares furent bradés à 30$ chacun. Un scandale que notre prêtre,
C’est pourtant ce qu’à dû subir un jeune prêtre envoyé évangéliser les populations paysannes dans les campagnes reculées autour de Cajamarca, qui, très peu de temps après l’installation de la mine, se fait porte-parole des ses paroissiens. Fidèle aux principes humanistes de l’Evangile, celui-ci ne peut rester silencieux lorsqu’il prend connaissance de la bouche des habitants du village de Porcon des méthodes d’expropriation employées par la compagnie minière. Car le droit de propriété péruvien est ainsi fait que si le paysan (ou une communauté paysanne) est propriétaire d’un terrain, les ressources de ce terrain ne lui appartiennent pas et ce qui se cache sous sa maison peut ainsi être loué par l’Etat sans même l’en informer (même si l’entreprise bénéficiaire est censée, par la suite, obtenir son accord…enfin, ça, c’est ce qui est écrit sur du papier). Sympathique comme conception de la propriété privée (et collective), non ? A l’époque, il n’existait pas de route pour accéder à ces villages distants seulement de 30 kilomètres de la grande ville. Ce qui, à pieds, constituait tout un périple et favorisait le complexe d’isolement des paysans. C’est comme cela que les premières expropriations se furent silencieusement, sous contrainte de la menace : « soit tu parts avec ce qu’on te donne, soit cela se fait par la force ». Si c’est un homme « blanc » et riche qui parle, alors on obéit. Les premiers hectares furent bradés à 30$ chacun. Un scandale que notre prêtre, 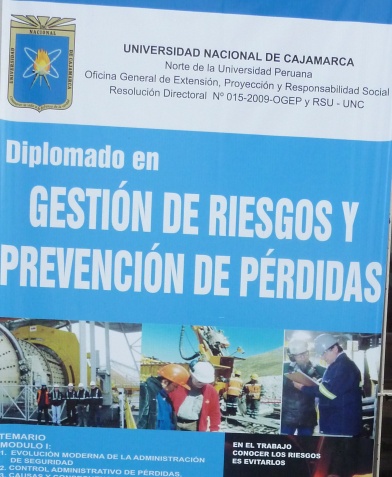 Malgré l’augmentation de la violence en ville et les bouleversements qu’elle subit suite à l’installation de la compagnie minière – migrations, apparition des bordels, etc. - les citadins continuent à voir ceux de la campagne comme des « cholos » ignorants et arriérés, qui se plaignent pour rien et qui ne connaissent pas leur chance. Il y a beaucoup de racisme social au Pérou… Pourtant, la contestation monte. Elle finira par prendre définitivement forme
Malgré l’augmentation de la violence en ville et les bouleversements qu’elle subit suite à l’installation de la compagnie minière – migrations, apparition des bordels, etc. - les citadins continuent à voir ceux de la campagne comme des « cholos » ignorants et arriérés, qui se plaignent pour rien et qui ne connaissent pas leur chance. Il y a beaucoup de racisme social au Pérou… Pourtant, la contestation monte. Elle finira par prendre définitivement forme 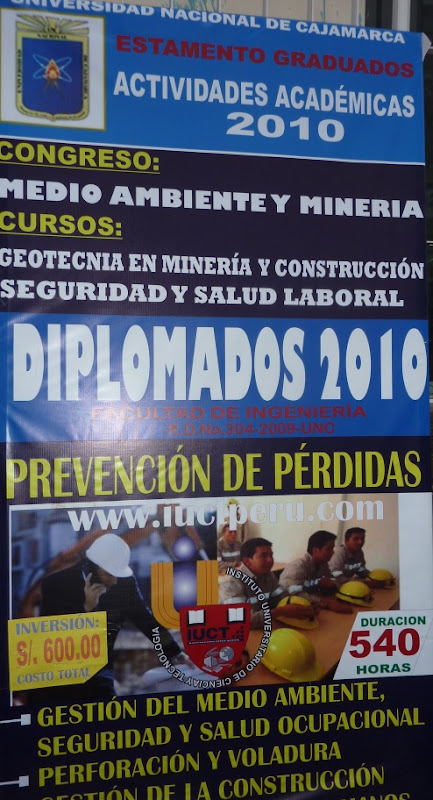 Du coup, lorsqu’un projet d’élargissement du site minier arrive aux oreilles des citadins en 2004, tous les ingrédients sont présents pour que l’opposition à la mine prenne encore plus d’ampleur. Il faut dire que si Yanacocha avait voulu le faire exprès, elle ne s’y serait pas prise autrement. Le nouveau projet devait en effet exploiter la colline où sont situées les sources qui fournissent la ville en eau. Très rapidement, la ville est assiégée et immobilisée, par ceux de la campagne dans un premier temps et par ceux de la ville par la suite. Pendant 15 jours, plus rien ne bouge. Grufides et le père Marco Arana sont au centre des événements. Le gouvernement de l’époque décide d’employer la force, mais sous-estime la colère des paysans, accumulée depuis des années. Ces derniers parviennent à faire fuir et à encercler un bataillon de forces anti-émeute. C’est seulement grâce à la médiation du prêtre que les choses en resteront là et qu’il n’y aura pas de victimes. Le projet est abandonné, et, forts de leur action, les membres de ce qui fut un groupe d’étudiants se retrouvent invités par la compagnie à participer à des tables de dialogue afin de solutionner les problèmes présents et futurs.
Du coup, lorsqu’un projet d’élargissement du site minier arrive aux oreilles des citadins en 2004, tous les ingrédients sont présents pour que l’opposition à la mine prenne encore plus d’ampleur. Il faut dire que si Yanacocha avait voulu le faire exprès, elle ne s’y serait pas prise autrement. Le nouveau projet devait en effet exploiter la colline où sont situées les sources qui fournissent la ville en eau. Très rapidement, la ville est assiégée et immobilisée, par ceux de la campagne dans un premier temps et par ceux de la ville par la suite. Pendant 15 jours, plus rien ne bouge. Grufides et le père Marco Arana sont au centre des événements. Le gouvernement de l’époque décide d’employer la force, mais sous-estime la colère des paysans, accumulée depuis des années. Ces derniers parviennent à faire fuir et à encercler un bataillon de forces anti-émeute. C’est seulement grâce à la médiation du prêtre que les choses en resteront là et qu’il n’y aura pas de victimes. Le projet est abandonné, et, forts de leur action, les membres de ce qui fut un groupe d’étudiants se retrouvent invités par la compagnie à participer à des tables de dialogue afin de solutionner les problèmes présents et futurs.  Aujourd’hui, mise à part les bains incas à quelques kilomètres du centre ville, la pièce où fut détenu Atahualpa, ainsi qu’un morceau de rocher vaguement creusé et recouvert par la mousse, situé sur une colline surplombant la ville qu’on appelle « le siège de l’Inca », il ne reste strictement rien de l’époque précolombienne. Ce qui n’empêche pas la ville d’avoir un centre ville colonial dans lequel il est agréable de flâner. D’autant plus agréable, qu’il s’agit de la capitale péruvienne des produits laitiers et donc … et oui, du fromage ! Ah, le fromage de Cajamarca, j’en garde des souvenirs émus. Comme je repense avec tendresse à mon ami, le dragon-chicken, dont j’avais souvent entendu parler mais que je pensais être une légende. Et bien, non, nous l’avons croisé tout de plumes et de feu vêtu. Il est tenancier d’un restaurant en centre ville. A l’origine, c’était un poulet qui en avait marre qu’on se moque de lui. Alors il a changé d’apparence. Ca me laisse rêveuse…
Aujourd’hui, mise à part les bains incas à quelques kilomètres du centre ville, la pièce où fut détenu Atahualpa, ainsi qu’un morceau de rocher vaguement creusé et recouvert par la mousse, situé sur une colline surplombant la ville qu’on appelle « le siège de l’Inca », il ne reste strictement rien de l’époque précolombienne. Ce qui n’empêche pas la ville d’avoir un centre ville colonial dans lequel il est agréable de flâner. D’autant plus agréable, qu’il s’agit de la capitale péruvienne des produits laitiers et donc … et oui, du fromage ! Ah, le fromage de Cajamarca, j’en garde des souvenirs émus. Comme je repense avec tendresse à mon ami, le dragon-chicken, dont j’avais souvent entendu parler mais que je pensais être une légende. Et bien, non, nous l’avons croisé tout de plumes et de feu vêtu. Il est tenancier d’un restaurant en centre ville. A l’origine, c’était un poulet qui en avait marre qu’on se moque de lui. Alors il a changé d’apparence. Ca me laisse rêveuse…



 en bas à gauche de chaque diaporama et enfin sur le petit triangle pour lire !
en bas à gauche de chaque diaporama et enfin sur le petit triangle pour lire !

