 Évidement, les deux rabat-joies qui m’accompagnent ne m’ont pas amenée ici pour me faire plaisir, ni pour que je puisse me régaler avec du fromage. Évidement, nous sommes aussi dans un lieu culte des conflits socio-environnementaux du Pérou. Selon la Defensoria del Pueblo, c’est le département péruvien qui connaît aujourd’hui le plus de conflits ouverts liés aux activités minières. Ici, quelque 43% du territoire de la région est concessionné à des entreprises minières, dont 100% de certains districts (celui de Cajamarca, où se trouve la capitale de la région l’est à 94% - il ne reste que le centre historique ?). Pas moins de 6 nouveaux sites miniers, tous situés sur les hauteurs ceinturant la ville, devraient ouvrir leurs portes, ou plutôt faire leurs trous (comme les souris), d’ici une à deux années. Certes, l’histoire de l’exploitation minière à Cajamarca ne vient pas de commencer, l’or était exploité dans la région depuis longtemps, à petite échelle... jusqu’à l’arrivée de la multinationale Yanacocha.
Évidement, les deux rabat-joies qui m’accompagnent ne m’ont pas amenée ici pour me faire plaisir, ni pour que je puisse me régaler avec du fromage. Évidement, nous sommes aussi dans un lieu culte des conflits socio-environnementaux du Pérou. Selon la Defensoria del Pueblo, c’est le département péruvien qui connaît aujourd’hui le plus de conflits ouverts liés aux activités minières. Ici, quelque 43% du territoire de la région est concessionné à des entreprises minières, dont 100% de certains districts (celui de Cajamarca, où se trouve la capitale de la région l’est à 94% - il ne reste que le centre historique ?). Pas moins de 6 nouveaux sites miniers, tous situés sur les hauteurs ceinturant la ville, devraient ouvrir leurs portes, ou plutôt faire leurs trous (comme les souris), d’ici une à deux années. Certes, l’histoire de l’exploitation minière à Cajamarca ne vient pas de commencer, l’or était exploité dans la région depuis longtemps, à petite échelle... jusqu’à l’arrivée de la multinationale Yanacocha.Cette dernière débarque au Pérou au début des années 1990, sous l’impulsion du Président de l’époque, Fujimori , adepte du néo-libéralisme sauvage, que beaucoup de Péruviens apprécient toujours, même s’ils déplorent tout de même ses carences en termes de démocratie. Pour l’anecdote, lorsque le vent tourne et qu’il s’enfuit du Pérou en profitant de sa double nationalité pour se réfugier au Japon, il va mettre à profit son expérience péruvienne en politique en intégrant un parti de l’extrême droite japonais, pour dire… A l’heure actuelle, parce que ça bouge souvent, le bougre (toutes mes excuses aux Bulgares que j’aime beaucoup) est tout de même en prison pour pas moins de six motifs d’inculpation différents et pour une durée supérieure aux années (25 ans) qu’ils lui restent à vivre. Trouver un moyen pour le libérer, c’est ce qui motiverait sa fille, Keiko Fujimori, à participer aux futures élections présidentielles de 2011. En Amérique Latine, plutôt que de s’embêter avec des affiches électorales, qui se déchirent, qui coutent cher et qui ne sont pas « développement durable », on peint sur le plus de murs possible le nom ou/et le slogan du son candidat préféré. Si on considère la fréquence des noms peints sur les murs comme un indicateur de popularité, au nombre de « KEIKO FUERZA FUJIMORI LIBERTAD » lus un peu partout dans le pays, elle semble en bonne voie pour gagner. Évidement, quelques nouveaux sols, la monnaie péruvienne, motivent souvent les gens à laisser peindre leur maison. Avec un père comme le sien, impossible qu’elle soit élue ? Il faut se souvenir que sur ce continent, niveau politique, tout est possible. Un exemple ? Ce sont les résultats économiques catastrophiques (inflation à 4 chiffres, 7649% en 1990) de son prédécesseur, Allan Garcia (économiste de formation), qui ont amené Fujimori au pouvoir. Alan Garcia, celui qui voit des chiens communistes former des bataillons de narcotrafiquants dans la forêt amazonienne. Le même que les Péruviens ont réélu en 2005, l’actuel président.
 Pour en revenir à Yanacocha, elle est la fille de deux entreprises - Newmont (Etats-Unis) et Buenaventura (Perú) - et d’une institution, la Banque Mondiale, qui en détient 5% des actions. Lors de son installation dans le pays, c’est l’allégresse. Tous les médias chantent les vertus de cette entreprise moderne. Grâce à sa technologie de pointe, elle va permettre de récupérer les grosses quantités d’or dont les gisements, pour des raisons géologiques propres à la région de Cajamarca, sont tous situés dans des zones de formation des sources d'eau, ce qui est particulièrement problématique en termes de pollution. Du fait de leur trop grand éparpillement et faute de technologie adaptée (et peut-être aussi parce que le cours de l’or n’était pas suffisamment élevé pour justifier l’investissement), le métal précieux cajamarquais n’était jusqu’alors pas exploité. Lorsque Yanacocha s’installe dans la région, les habitants apprennent dans les journaux qu’en plus de ne générer aucun impact pour l’environnement grâce à ses technologies modernes et de développer cette région de paysans endormis en leur donnant du travail, l’entreprise va enrichir tout les Péruviens grâce aux impôts qu’elle paiera à l’Etat.
Pour en revenir à Yanacocha, elle est la fille de deux entreprises - Newmont (Etats-Unis) et Buenaventura (Perú) - et d’une institution, la Banque Mondiale, qui en détient 5% des actions. Lors de son installation dans le pays, c’est l’allégresse. Tous les médias chantent les vertus de cette entreprise moderne. Grâce à sa technologie de pointe, elle va permettre de récupérer les grosses quantités d’or dont les gisements, pour des raisons géologiques propres à la région de Cajamarca, sont tous situés dans des zones de formation des sources d'eau, ce qui est particulièrement problématique en termes de pollution. Du fait de leur trop grand éparpillement et faute de technologie adaptée (et peut-être aussi parce que le cours de l’or n’était pas suffisamment élevé pour justifier l’investissement), le métal précieux cajamarquais n’était jusqu’alors pas exploité. Lorsque Yanacocha s’installe dans la région, les habitants apprennent dans les journaux qu’en plus de ne générer aucun impact pour l’environnement grâce à ses technologies modernes et de développer cette région de paysans endormis en leur donnant du travail, l’entreprise va enrichir tout les Péruviens grâce aux impôts qu’elle paiera à l’Etat. Cela, c’est pour la face visible. Face cachée, c’est une autre histoire. L’installation de la mine est un cas d’école. D’ailleurs, pour l’anecdote, l’exploitation aurait pu être française (voir comment la France à perdu la concession), mais c’était sans compter sur l’intervention de la CIA - dès sa création, Yanacocha sent le souffre. Mais c’est une belle grande compagnie, et il est de bon ton de l’aimer. En dire du mal, c’est être communiste. Et au Pérou, « être communiste » peut être une accusation grave. Pendant 12 ans (de 1980 au 1992 officiellement), les Péruviens ont eu à souffrir d’une guérilla maoïste à la péruvienne et d’une contre-guérilla-terrorisme-d’Etat à la colombienne. C’est en partie pour des crimes commis par les paramilitaires sur les populations paysannes des Andes qu’est enfermé Fujimori. Quant à la guérilla, extrêmement violente et aux allures sectaires, ses méthodes pour bâtir le « sentier lumineux » vers la révolution devant mettre en place un communisme andin n’avaient pas grand-chose à voir avec les idéaux des libérateurs de la classe opprimée, et les mêmes paysans andins, pris en étau entre le « sentier » et l’armée, se trouvaient parmi ses premières victimes. Le qualificatif « communiste » réveille chez beaucoup de Péruviens de mauvais souvenirs et il n’est pas bon de se le voir affliger par les autorités et les médias.
 C’est pourtant ce qu’à dû subir un jeune prêtre envoyé évangéliser les populations paysannes dans les campagnes reculées autour de Cajamarca, qui, très peu de temps après l’installation de la mine, se fait porte-parole des ses paroissiens. Fidèle aux principes humanistes de l’Evangile, celui-ci ne peut rester silencieux lorsqu’il prend connaissance de la bouche des habitants du village de Porcon des méthodes d’expropriation employées par la compagnie minière. Car le droit de propriété péruvien est ainsi fait que si le paysan (ou une communauté paysanne) est propriétaire d’un terrain, les ressources de ce terrain ne lui appartiennent pas et ce qui se cache sous sa maison peut ainsi être loué par l’Etat sans même l’en informer (même si l’entreprise bénéficiaire est censée, par la suite, obtenir son accord…enfin, ça, c’est ce qui est écrit sur du papier). Sympathique comme conception de la propriété privée (et collective), non ? A l’époque, il n’existait pas de route pour accéder à ces villages distants seulement de 30 kilomètres de la grande ville. Ce qui, à pieds, constituait tout un périple et favorisait le complexe d’isolement des paysans. C’est comme cela que les premières expropriations se furent silencieusement, sous contrainte de la menace : « soit tu parts avec ce qu’on te donne, soit cela se fait par la force ». Si c’est un homme « blanc » et riche qui parle, alors on obéit. Les premiers hectares furent bradés à 30$ chacun. Un scandale que notre prêtre, Marco Arana de son nom, ne peut taire.
C’est pourtant ce qu’à dû subir un jeune prêtre envoyé évangéliser les populations paysannes dans les campagnes reculées autour de Cajamarca, qui, très peu de temps après l’installation de la mine, se fait porte-parole des ses paroissiens. Fidèle aux principes humanistes de l’Evangile, celui-ci ne peut rester silencieux lorsqu’il prend connaissance de la bouche des habitants du village de Porcon des méthodes d’expropriation employées par la compagnie minière. Car le droit de propriété péruvien est ainsi fait que si le paysan (ou une communauté paysanne) est propriétaire d’un terrain, les ressources de ce terrain ne lui appartiennent pas et ce qui se cache sous sa maison peut ainsi être loué par l’Etat sans même l’en informer (même si l’entreprise bénéficiaire est censée, par la suite, obtenir son accord…enfin, ça, c’est ce qui est écrit sur du papier). Sympathique comme conception de la propriété privée (et collective), non ? A l’époque, il n’existait pas de route pour accéder à ces villages distants seulement de 30 kilomètres de la grande ville. Ce qui, à pieds, constituait tout un périple et favorisait le complexe d’isolement des paysans. C’est comme cela que les premières expropriations se furent silencieusement, sous contrainte de la menace : « soit tu parts avec ce qu’on te donne, soit cela se fait par la force ». Si c’est un homme « blanc » et riche qui parle, alors on obéit. Les premiers hectares furent bradés à 30$ chacun. Un scandale que notre prêtre, Marco Arana de son nom, ne peut taire.L’évêque du coin, du côté du peuple évidement, lorsqu’il a vent de l’existence d’un prêtre « rouge » sous son autorité, le rappelle à l’ordre en l’expédiant deux ans à Rome pour y faire des études, et lorsque celui-ci revient dans sa région, une paroisse est crée spécialement pour lui : celle de l’université de Cajamarca. Erreur ! Des étudiants issus d’organisations religieuses proches de la théologie de la libération et un prêtre engagé, tous les éléments semblent réunis pour que la contestation prenne de l’ampleur. Ce qui fut effectivement le cas.
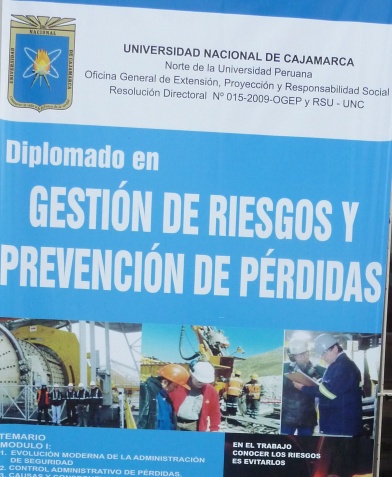 Malgré l’augmentation de la violence en ville et les bouleversements qu’elle subit suite à l’installation de la compagnie minière – migrations, apparition des bordels, etc. - les citadins continuent à voir ceux de la campagne comme des « cholos » ignorants et arriérés, qui se plaignent pour rien et qui ne connaissent pas leur chance. Il y a beaucoup de racisme social au Pérou… Pourtant, la contestation monte. Elle finira par prendre définitivement forme lorsqu’en 2000, suite à un accident de transport, 151 kilos de mercure sont déversés dans le village de Choropampa. Le scandale sanitaire est énorme. De nombreux habitants sont touchés. Toute l’histoire est relatée dans un documentaire réalisé par nos amis de Guarango. En ville, les étudiants proches du prêtre Marco Arana décident de diffuser ce documentaire sur la place principale (évidement nommée plaza des armas) pour qu’enfin tout le monde sache ce qui se passe. C’est ainsi que l’image d’entreprise responsable de Yanacocha commence à pâlir aux yeux de l’opinion publique. C’est ainsi également que l’entreprise minière remarque l’existence de ce groupe d’indésirables, qui a fini par se structurer pour devenir une ONG, connue sous le nom de GRUFIDES. Comme bien souvent, ce sont de jeunes citadins universitaires, et notamment juristes, scandalisés par la situation de ceux de la campagne. C’est en attaquant au niveau de la loi qu’ils tentent de défendre les paysans qui souffrent de plus en plus ouvertement de l’activité minière : disparition des sources d’eau, contamination des rivières et des canaux d’irrigation utilisés aussi comme sources d’eau potable, expropriations déguisées en actes de vente, etc.
Malgré l’augmentation de la violence en ville et les bouleversements qu’elle subit suite à l’installation de la compagnie minière – migrations, apparition des bordels, etc. - les citadins continuent à voir ceux de la campagne comme des « cholos » ignorants et arriérés, qui se plaignent pour rien et qui ne connaissent pas leur chance. Il y a beaucoup de racisme social au Pérou… Pourtant, la contestation monte. Elle finira par prendre définitivement forme lorsqu’en 2000, suite à un accident de transport, 151 kilos de mercure sont déversés dans le village de Choropampa. Le scandale sanitaire est énorme. De nombreux habitants sont touchés. Toute l’histoire est relatée dans un documentaire réalisé par nos amis de Guarango. En ville, les étudiants proches du prêtre Marco Arana décident de diffuser ce documentaire sur la place principale (évidement nommée plaza des armas) pour qu’enfin tout le monde sache ce qui se passe. C’est ainsi que l’image d’entreprise responsable de Yanacocha commence à pâlir aux yeux de l’opinion publique. C’est ainsi également que l’entreprise minière remarque l’existence de ce groupe d’indésirables, qui a fini par se structurer pour devenir une ONG, connue sous le nom de GRUFIDES. Comme bien souvent, ce sont de jeunes citadins universitaires, et notamment juristes, scandalisés par la situation de ceux de la campagne. C’est en attaquant au niveau de la loi qu’ils tentent de défendre les paysans qui souffrent de plus en plus ouvertement de l’activité minière : disparition des sources d’eau, contamination des rivières et des canaux d’irrigation utilisés aussi comme sources d’eau potable, expropriations déguisées en actes de vente, etc. Petit à petit, au bout de presqu’une décennie d’activités, Yanacocha voit apparaitre une résistance organisée à son activité. Autant les méthodes d’implantation de l’entreprise peuvent être considérées comme un cas d’école, autant la structuration de la résistance à son activité est représentative des mouvements d’opposition aux entreprises minières, notamment dans le nord du Pérou : un membre local de l’Eglise qui s’insurge de voir la morale chrétienne bafouée se fait l’écho des préoccupations de ses paroissiens qui voient leur instrument de subsistance, la terre, attaquée, endommagée ou volée. En ville, quelques jeunes, proches de l’Eglise, étudiants en droit et/ou écologistes sont interpellés par cette injustice et décident de se saisir du sujet et de contre-attaquer au niveau légal. En conséquence, sentant que ce qu’elles vivent n’est finalement peut-être pas une fatalité, puisque des universitaires, des « licenciés », des « docteurs » de la ville, les soutiennent, les anciennes organisations paysannes, qui existaient pour d’autre motifs, reprennent l’espoir et s’organisent. Pour les entreprises minières, le mal est fait. Puis, vient le drame, l’accident visible. La pointe émergée de l’iceberg. Celui-ci est médiatisé. Pour l’opinion publique, les choses ne sont plus comme avant. Au Pérou, il y a un avant Choropampa et un après.
 Du coup, lorsqu’un projet d’élargissement du site minier arrive aux oreilles des citadins en 2004, tous les ingrédients sont présents pour que l’opposition à la mine prenne encore plus d’ampleur. Il faut dire que si Yanacocha avait voulu le faire exprès, elle ne s’y serait pas prise autrement. Le nouveau projet devait en effet exploiter la colline où sont situées les sources qui fournissent la ville en eau. Très rapidement, la ville est assiégée et immobilisée, par ceux de la campagne dans un premier temps et par ceux de la ville par la suite. Pendant 15 jours, plus rien ne bouge. Grufides et le père Marco Arana sont au centre des événements. Le gouvernement de l’époque décide d’employer la force, mais sous-estime la colère des paysans, accumulée depuis des années. Ces derniers parviennent à faire fuir et à encercler un bataillon de forces anti-émeute. C’est seulement grâce à la médiation du prêtre que les choses en resteront là et qu’il n’y aura pas de victimes. Le projet est abandonné, et, forts de leur action, les membres de ce qui fut un groupe d’étudiants se retrouvent invités par la compagnie à participer à des tables de dialogue afin de solutionner les problèmes présents et futurs.
Du coup, lorsqu’un projet d’élargissement du site minier arrive aux oreilles des citadins en 2004, tous les ingrédients sont présents pour que l’opposition à la mine prenne encore plus d’ampleur. Il faut dire que si Yanacocha avait voulu le faire exprès, elle ne s’y serait pas prise autrement. Le nouveau projet devait en effet exploiter la colline où sont situées les sources qui fournissent la ville en eau. Très rapidement, la ville est assiégée et immobilisée, par ceux de la campagne dans un premier temps et par ceux de la ville par la suite. Pendant 15 jours, plus rien ne bouge. Grufides et le père Marco Arana sont au centre des événements. Le gouvernement de l’époque décide d’employer la force, mais sous-estime la colère des paysans, accumulée depuis des années. Ces derniers parviennent à faire fuir et à encercler un bataillon de forces anti-émeute. C’est seulement grâce à la médiation du prêtre que les choses en resteront là et qu’il n’y aura pas de victimes. Le projet est abandonné, et, forts de leur action, les membres de ce qui fut un groupe d’étudiants se retrouvent invités par la compagnie à participer à des tables de dialogue afin de solutionner les problèmes présents et futurs. De bonne fois, les anciens étudiants acceptent. Pendant deux ans, la priorité est donnée au dialogue et les petits conflits qui surgissent en 2005 et en 2006 sont rapidement résolus par la multinationale qui semble s’être découverte une conscience. Malheureusement, lorsqu’en 2007, suite à un conflit du travail, les gardes de sécurité armés de l’entreprise tuent un des employés, les relations se tendent. Pour totalement se rompre quelque temps plus tard, lorsque la présidente de l’association et le père Marco Arana découvrent qu’ils sont suivis par les mêmes services de sécurité depuis un moment. Dignes d’un film de James Bond, les espions avaient maquillé une vitrine en faux bureau, derrière lequel se trouvait une pièce entière recouverte de photos des « suspects », ainsi que celles de leurs proches et leurs amis. Des heures de bande vidéo sur lesquels ils sont filmés sont aussi découvertes. Toute leur vie est consignée. Alors, dans ces conditions, il n’est plus question de s’assoir à la même table.
Aujourd’hui, l’entreprise exerce toujours son activité et provoque des conflits. La nouveauté, c’est qu’elle n’est plus la seule. Environ une dizaine de projets miniers ont fleuri depuis, un peu partout dans la région. Alors, aujourd’hui, le prêtre, qui dans sa jeunesse, il y a 17 ans maintenant, s’était fait l’écho de ses paroissiens, paysans peinant à parler l’espagnol, a crée son parti politique. Celui-ci se nomme « terre et liberté » (Tierra y Libertad) en souvenir de la révolution mexicaine. En plus de participer aux élections régionales d’octobre 2010, Marco Arana est aussi candidat à la présidence du pays en 2011. s'il arrive à récuperer suffisement de signatures. La militance serait-elle un tremplin pour faire de la politique ? « Pas vraiment », nous répond la présidente de Grufides : « c’est qu’après tant d’années de lutte, nous en avons assez de voir que la situation empire plutôt qu’elle ne s’améliore. Alors, il s’est dit qu’il allait essayer de la changer lui-même, de la seule manière possible, c'est-à-dire en devenant Président du pays ». Et pour cela, il est prêt à sacrifier sa soutane !
On ne peut que le comprendre quand on voit la situation actuelle. Quasiment 20 ans de lutte et quasiment 20 ans de pleurs. Même si localement, certaines victoires sont remportées, globalement les choses vont de plus en plus mal. A l’heure actuelle, une des communautés de la région de Cajamarca, El Tingo est quasiment en situation d’insurrection. En effet, ils ont été choisis comme cobaye pour tester la récente résurrection de la loi de servidiumbre minera, littéralement de servitude minière. Ce monstre anticonstitutionnel avait été crée sous une des présidences de notre ami Fujimori. La loi avait sagement dormi dans un carton, pour finalement être recyclée aujourd’hui. Son principe est le suivant : lorsque ceux qu’on nomme au Pérou « propriétaires superficiels » ne se mettent pas d’accord avec l’entreprise minière sur la vente de leurs terres, celle-ci peut demander à l’Etat l’application de la servitumbre, à savoir – après une nouvelle tentative de concertation et si celle-ci échoue – de nommer un expert qui valorisera les terres convoitées, après quoi il suffira à l’entreprise de verser à l’Etat (Banque de la nation) une certaine somme pour l’achat du terrain dont l’ancien propriétaire se verra notifier de son expropriation par voie postale. Il ne lui reste plus qu’à faire ses bagages et à aller chercher son chèque à la Banque de la nation. A El Tingo, « los cholos » incultes du coin, ont bien conscience d’une chose : s’ils cèdent, ils laissent le gouvernement ouvrir la boite de Pandore. Alors ils résistent et ils sont prêts à aller jusqu’au bout. Après Bagua le 5 juin 2009, El Tingo un jour ? On espère que non, mais on craint le pire !
On en parle sur Aldeah.
--
Kri kri
Irkita
 en bas à gauche de chaque diaporama et enfin sur le petit triangle pour lire !
en bas à gauche de chaque diaporama et enfin sur le petit triangle pour lire ! Bonjour,
Bonjour,


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire